C’est la nécessité de désigner un ennemi, dont il faudrait triompher, qui fait la véritable filiation du régime de Vladimir Poutine avec ceux instaurés par ses prédécesseurs soviétiques, écrit l’historien Georges Nivat.
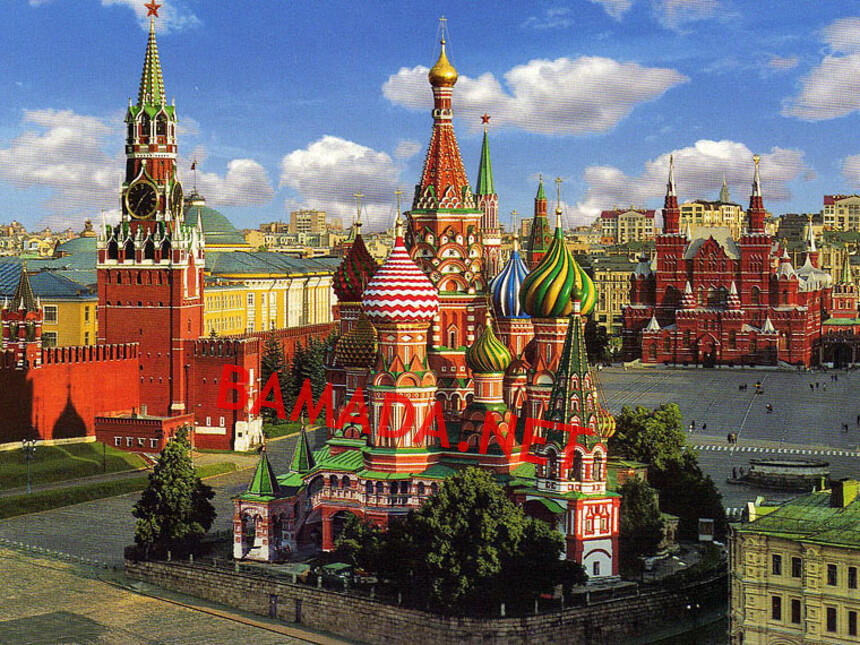
Beaucoup se demandent si l’actuelle Russie prolonge ou non l’ancienne URSS. Au temps déjà lointain de la perestroïka, certains conclurent vite que l’URSS était finie, et s’agaçaient que l’on continuât de parler du goulag – à quoi bon ces redites ? Le goulag et son « archipel », c’était fini, sombré dans le passé. Cependant, Svetlana Alexeievitch, dans La Fin de l’homme rouge (2013), redécouvrait, parmi d’autres encore, l’« Homo sovieticus » d’hier sous le « citoyen » d’aujourd’hui. Qu’en penser ?
La période soviétique a laissé derrière elle plusieurs strates. Nous pouvons, à grands traits, en compter trois : la dernière, que pour simplifier nous qualifierons de « brejnévienne », était un despotisme adouci, à moitié moribond, quoique encore capable d’engager une catastrophique « guerre de libération » en Afghanistan. Ne comptent vraiment que les deux premières, celles qui ont laissé des traces indélébiles – comme auparavant le servage, instauré au XVIe siècle et considérablement étendu par Catherine la Grande, tout particulièrement en Ukraine. Ainsi, l’amie des philosophes, le modèle du despote éclairé, fut aussi une esclavagiste.
La première strate correspond au projet de Lénine. Pour ce dernier, l’important était avant tout de vaincre les bourgeois et leurs alliés socialistes modérés : sa plus stupéfiante décision fut d’adopter un défaitisme extrême pendant la première guerre mondiale, dès août 1914, alors que se déchaînait en Russie une brève hystérie antiallemande – laquelle produisit même quelques poèmes signés de Vladimir Maïakovski. Ce défaitisme fanatique de Lénine interloqua plusieurs bolcheviques, surtout ceux restés à l’intérieur de l’empire. Après quoi, il s’agit de gagner coûte que coûte la guerre civile, ce qui fut fait par Trotski, avec son train blindé. Cela prit trois ans, de 1918 à 1921, avec la révolte paysanne de Tambov. Des deux côtés, le carburant de cette guerre civile était le fanatisme – ne cherchons pas à minimiser la foi bolchevique, dont le normalien Pierre Pascal en est un bel exemple : officier français, il choisit en 1918 de rester en Russie, fonda le Groupe communiste français de Moscou, travailla pour l’Internationale et voyait dans le communisme russe un retour à la première communauté chrétienne de Jérusalem, égalitariste et collectiviste.
Acceptation intime de la défaite
Cette foi fut le moteur d’une cruauté qui sévit des deux côtés, l’essentiel étant le résultat. Céder l’Ukraine lors du traité de paix séparée entre la Russie rouge et les puissances de la triple alliance, le 3 mars 1918, ne fut pas un problème pour Lénine. Toutes les familles furent partagées : Leonid Leonov, Boris Pilniak, et toute la littérature soviétique des années 1920 font le récit de cette déchirure entre frères ennemis ; les vaincus ne pouvant et ne devant survivre qu’avec l’acceptation intime de la défaite, comme dans Les Vaincus, d’Irina Golovkina. L’intimité de la guerre était incrustée en chacun. Andreï Platonov, l’auteur de Tchevengour, en fit la plus extraordinaire illustration, mêlant intimement l’utopisme anarchique et la cruauté.